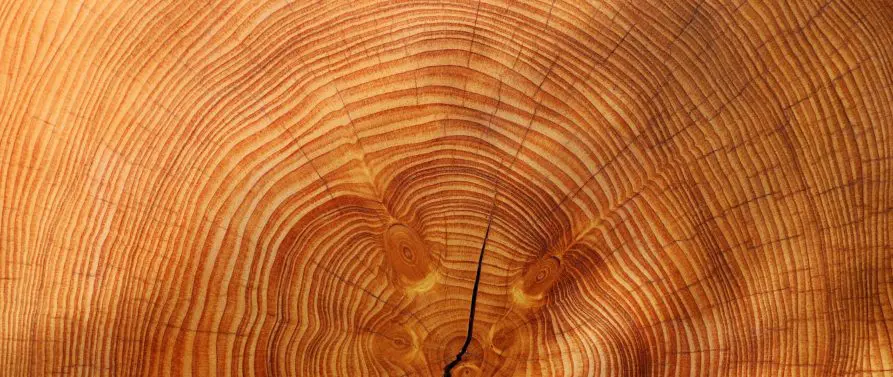Le bois, matériau d’avenir : une alternative concrète au béton en architecture
Alors que le béton domine encore nos villes, le bois s’impose comme une alternative crédible, performante et durable. Porté par l’urgence climatique et les innovations techniques, il redéfinit l’architecture contemporaine.
Pendant des décennies, le béton a régné sans partage sur nos paysages bâtis. Associé à la modernité, à la robustesse et à la rapidité de construction, il a façonné nos villes et nos habitudes de construction. Mais aujourd’hui, à l’heure des impératifs climatiques, un retour aux sources s’opère. Le bois, matériau ancestral, fait un retour remarqué – non pas comme accessoire décoratif ou rustique, mais comme véritable alternative structurelle au béton. Et cette révolution silencieuse a déjà commencé.
Le bois, un matériau structurel à part entière
Grâce aux avancées techniques des dernières décennies, le bois ne se limite plus aux charpentes ou aux chalets. Des immeubles de plus de 10 étages, comme le célèbre HoHo à Vienne (24 étages, 84 mètres), ou la tour Brock Commons à Vancouver (18 étages), ont été réalisés en bois. Ces systèmes permettent des portées importantes, une résistance au feu parfaitement contrôlée, une excellente isolation thermique et phonique, et surtout une réduction des délais de chantier par rapport à des constructions traditionnelles.
Une réponse aux défis écologiques
L’un des plus grands atouts du bois est qu’il est renouvelable, stockeur de carbone, et faiblement transformé. Chaque mètre cube de bois stocke environ 0,9 tonne de CO₂. En comparaison, la production d’une tonne de ciment émet environ 600 à 900 kg de CO₂. Dans une époque où le secteur du bâtiment est responsable de près de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, construire en bois n’est pas seulement une option technique : c’est un acte de responsabilité écologique.
En Suisse, la forêt couvre plus de 30 % du territoire et le bois local représente un gisement considérable, renouvelable, et encore largement sous-exploité. Exploiter durablement cette ressource permettrait de renforcer l’autonomie de nos filières et de soutenir l’économie locale.
Durabilité et longévité : casser les idées reçues
Contrairement à une croyance tenace, le bois bien conçu n’est pas un matériau fragile ou éphémère. Des structures en bois datant de plusieurs siècles – comme les temples japonais ou certains ponts couverts alpins – témoignent de sa durabilité. En Suisse, la durée de vie d’un bâtiment en bois est estimée à plus de 100 ans, à condition que les principes de conception hygroscopique soient respectés. De plus, la maintenance est souvent plus simple et moins coûteuse que pour des matériaux nécessitant des traitements chimiques ou des démolitions lourdes.
Des avantages multiples pour l’architecture
Outre son impact environnemental positif, le bois offre des qualités esthétiques, sensorielles et techniques très appréciées : une chaleur visuelle, une acoustique naturelle, une légèreté dans les volumes. Il permet une architecture expressive, modulaire, et respectueuse de son environnement. Le bois pèse environ cinq fois moins que le béton, ce qui réduit les charges sur les fondations, un avantage important en rénovation ou en surélévation.
Une transformation à accompagner
Pour que le bois devienne une norme plutôt qu’une exception, il reste encore des freins à lever : formation des acteurs, filières locales à structurer, modèles d’assurance à adapter. Mais les signaux sont encourageants : en Suisse, la part de marché des constructions en bois est passée de 10 % à près de 17 % en dix ans, et des cantons comme le Valais, Fribourg ou Vaud encouragent désormais l’utilisation de matériaux biosourcés dans les marchés publics.
Le bois n’est pas un retour en arrière. C’est une avancée réfléchie, technique et engagée vers un avenir du bâtiment plus sobre, plus sain et plus résilient.